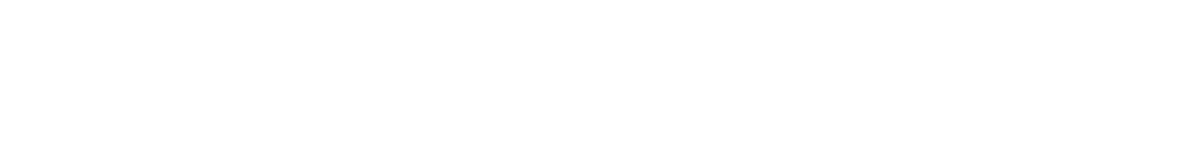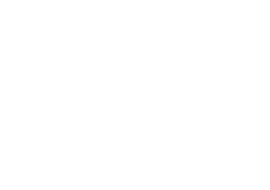|
Résumé :
|
L'essor remarquable qu'a pris la botanique au XIX* siècle est dû en grande partie aux savants français : des travaux de Lamarck et de Dutrochet est née la biologie végétale. Avant le XIXe siècle, des conceptions purement philosophiques paralysaient la recherche scientifique dans ce domaine. La théorie d'Aristote servait à expliquer le mécanisme de tous les phénomènes de la vie. Cette théorie répondait à tous les « pourquoi » par des notions toutes faites, telle que la « cause finale », vers laquelle tend chaque être ou bien cette fameuse force vitale, qu'on croyait à l'origine de chaque phénomène observé sans l'expliquer davantage. Ce n'est qu'en brisant définitivement avec ces idées que la botanique a pu prendre place parmi les sciences.Dutrochet a été l'ennemi le plus acharné de l'aristotélisme. Il rejeta ses notions arbitraires et abstraites et chercha le concours de la physique pour expliquer la vie des plantes. Les phénomènes essentiels de la vie végétale : l'absorption, la circulation et la transpiration, l'assimilation et la respiration furent découverts l'un après l'autre. L'ensemble des formes si diverses qu'arrive à prendre la matière vivante devint aussi l'objet d'études approfondies. Un nom émerge parmi ceux des botanistes français : celui de Van Tieghem. C'est lui qui parvint à distinguer clairement les organes chez les parties supérieures en établissant que tous les organes des végétaux vasculaires se rattachent à trois types fondamentaux : la racine, la tige et la feuille. La connaissance de la répartition des formes dans l'espace et dans le temps fut aussi approfondie et enrichie. C'est ainsi que deux disciplines nouvelles furent créées : la phytogéographie, étudiant le groupement des végétaux par régions, et la paléobotanique, s'occupant de leur histoire et de leur évolution.
|